

Parcours Aventure (17 mars 2002)
Point
n'est besoin d'aller au fin fond de l'Amazonie pour chercher l'aventure. Elle
est à notre porte pour qui sait la trouver. Les yeux me brûlent
et j'ai le corps moulu. J'ai dû me dépasser, aller au bout de
mes capacités et transcender ma peur. Nous avons tous l'impression
d'avoir accompli des exploits... mais c'est parce qu'aucun incident n'est
venu gâcher notre plaisir.
Nous sommes partis pour une balade pépère, 200 mètres de dénivelé, promenade sur les crêtes au-dessus de Saint Jean Pied de Port. Richard m'avait même dit que je pouvais proposer à ma mère de venir. Elle a dû avoir un pressentiment, parce qu'elle a préféré inviter mes enfants à déjeuner pendant notre absence dominicale. Le printemps commence de bonne heure cette année. Les bourgeons éclatent de toutes parts, et peignent un tableau pointilliste de verts tendres et crus. Les cerisiers sauvages et cultivés arborent leurs dômes de fleurs blanches, les pêchers roses, les forsythias jaunes et les premières glycines mauves font assaut de leurs charmes auprès des premiers insectes de la saison : c'est un plaisir pour les yeux. A Saint Jean Pied de Port, Richard, les yeux sur la carte, nous guide sans hésitation : à droite, direction Saint Michel, attention, c'est ici qu'on tourne, c'est marqué Urkulu. La voiture attaque la montée très raide sur une route étroite où les voitures ne peuvent se croiser que par endroits. Bientôt, nous longeons le précipice et nous songeons à cet automobiliste qui n'a eu qu'une cheville brisée après avoir dévalé la falaise de la corniche après Saint Jean de Luz. Nous n'avons pas envie de vérifier si nous aurons autant de chance. Richard toujours enthousiaste, ne cesse de louer la beauté du Pays Basque et demande toutes les cinq minutes à Christophe, le jeune allemand de seize ans, correspondant de sa fille aînée, s'il apprécie le paysage.
Ma
voiture a pris l'habitude de caler de façon aussi impromptue qu'inopportune,
particulièrement lorsque le moteur est froid, que je ralentis ou que
je change de vitesse (les injecteurs se bouchent, paraît-il). Jean-Louis,
qui a pris le volant exceptionnellement, s'énerve et stresse Richard,
assis à la place du mort, qui a tendance à être malade
et inquiet en voiture lorsqu'il ne conduit pas : avec ces deux là devant,
j'ai l'impression que nous n'arriverons jamais tandis que Christophe, imperturbable,
regarde à l'extérieur. Les quatre voitures se suivent lentement
et nous commençons à entendre le vent siffler à travers
les interstices ; l'air a considérablement refroidi par rapport à
la plaine, il vient du sud mais passe sur les cimes enneigées dont
il nous apporte les effluves glacées.
Richard nous désigne le petit sommet à atteindre : la base d'une tour romaine élaborée avec les roches grises dégagées par l'érosion sur le point culminant défie le temps qui passe. Nous ne nous en apercevons pas sur le moment, mais ces pierres sont les vestiges des récifs coralliens datant de 80 millions d'années (je crois) qui se formaient dans les eaux tropicales de la région, avant l'érection de la chaîne pyrénéenne (comme la Barrière de Corail australienne). Urkulu marque la frontière de la Novempopulanie, région "des neufs peuples" dominée par les Romains il y a quelque 2000 ans, à l'époque lointaine où Bayonne, qui avait été érigée en rempart contre les envahisseurs ibères et vikings, s'appelait Lapurdum.
Les
rafales de vent sont tellement fortes que nous arrivons à peine à
ouvrir les portes des voitures. Tout de suite, malgré le ciel bleu
et le soleil, nous sommes frigorifiés. J'attrape mes vêtements
chauds et les enfile à toute vitesse. Pierre a oublié d'apporter
un anorak et un bonnet. Sylvie et ses enfants ne sortent même pas de
leur véhicule et décident de redescendre aux sources de la Nive.
Christophe n'est pas non plus assez couvert et empreinte un vêtement
à Jean-Louis. Nous commençons à monter ; les extrémités
des doigts se gèlent malgré les manches d'anorak descendues
au maximum sur les mains. Heureusement, au bout de cinq minutes de marche
d'un bon pas, le corps se réchauffe vite, et nous pouvons faire une
courte halte pour apprécier la vue qui porte loin sur la mer, la barre
de la ZUP de Bayonne, impossible à ignorer, et le mince ruban blond
du début de la côte landaise. Richard nous désigne les
sommets environnants : nous les avons tous "faits" pratiquement.
L'un des jumeaux traîne la jambe et Michèle, qui n'aime pas trop
le froid ni le vent, redescend avec ses enfants s'abriter dans sa voiture.
Cette tour a un diamètre important.
Elle devait servir d'abri aux guetteurs qui surveillaient les Ibères, leurs voisins turbulents. Jean-Louis s'étonne de sa position dans un endroit aussi isolé. Renseignements pris, elle aurait été érigée au 1er siècle avant J.-C. (à l'époque de Pompée ou d'Auguste), et n'aurait eu qu'une fonction symbolique pour commémorer une victoire, marquer les limites d'un territoire pacifié et démontrer la force du pouvoir militaire sur la frontière.
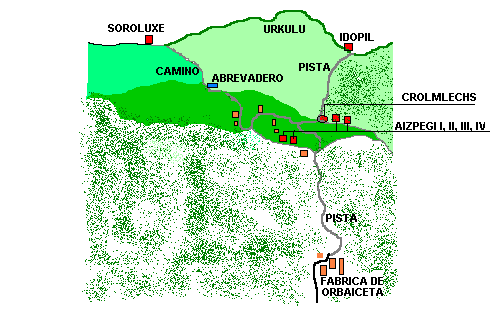 Il
est difficile d'imaginer que cette montagne d'Urkulu n'ait pas été
toujours pelée comme elle l'est à l'heure actuelle. Il est probable
qu'elle était plus boisée, peut-être plus peuplée
si la température était plus clémente, les éleveurs
n'avaient sans doute pas autant défriché de terres pour les
transformer en pâturages pour leurs brebis et Louis XIV n'avait pas
encore fait abattre des forêts entières pour la constitution
de sa flotte navale... D'ailleurs, les habitants du néolithique y ont
laissé leur marque non loin de là, sur le versant espagnol :
cromlechs et dolmens se dressent en plusieurs sites à Aizpegi et Soroluxe,
à la base du mont Urkulu, que nous pourrons aller voir en des temps
plus cléments.
Il
est difficile d'imaginer que cette montagne d'Urkulu n'ait pas été
toujours pelée comme elle l'est à l'heure actuelle. Il est probable
qu'elle était plus boisée, peut-être plus peuplée
si la température était plus clémente, les éleveurs
n'avaient sans doute pas autant défriché de terres pour les
transformer en pâturages pour leurs brebis et Louis XIV n'avait pas
encore fait abattre des forêts entières pour la constitution
de sa flotte navale... D'ailleurs, les habitants du néolithique y ont
laissé leur marque non loin de là, sur le versant espagnol :
cromlechs et dolmens se dressent en plusieurs sites à Aizpegi et Soroluxe,
à la base du mont Urkulu, que nous pourrons aller voir en des temps
plus cléments.
De la neige se niche dans un creux au bas de la tour et Pierre, comique avec son bermuda enfilé sur la tête en un vague turban fixé avec un large élastique, ne manque pas de nous bombarder. Nous apercevons, côté montagne, la pointe blanche triangulaire du Pic d'Anie et l'autre, qui paraît plus haute parce qu'elle est plus proche, du Pic d'Orhy. Des nuages commencent à se former, minces filaments vite déchirés par les courants violents. En montant, nous étions bousculés et manquions de tomber en escaladant les roches et la muraille. En descendant, j'écarte largement les bras et l'air me soutient : je suis un vautour et je plane en silence, seul le sifflement dans mes oreilles dénonce le mouvement insensible. Nous rions de plaisir. C'est dommage que Sylvie et Michèle ne le partagent pas. Richard avait prévu que nous continuions après à marcher sur les crêtes, mais il fait décidément trop froid, et Jean-Luc propose que nous rejoignions Sylvie. Nous nous serions bien arrêtés à mi-pente pour continuer à marcher plus à l'abri du vent mais Richard n'est plus le guide et c'est Jean-Luc, dans la voiture de Pierre, qui mène l'expédition désormais. Nous redescendons sur Saint Jean Pied de Port, passons par Saint Michel et Esterençubi pour nous apercevoir à la fin que nous aurions fort bien pu nous éviter ce détour en continuant la route des crêtes qui descend ensuite dans la forêt d'Orion.
Nous
nous arrêtons près d'une ferme boueuse et nauséabonde
et empruntons un large sentier qui nous mène à un lieu de pique
nique enchanteur, en bordure de la Nive qui dévale l'étroit
canyon en un torrent bruyant. Sylvie, Diana et Julien sont bien là.
Il n'est que midi, mais ce bol d'air nous a ouvert l'appétit et chacun
s'installe. Jean-Louis a apporté une demi-bouteille de rosé,
Richard du cidre, et Jean-Luc arrose de rhum le gâteau de Sylvie pour
en faire un baba onctueux et nourrissant. A la fin de ces agapes, nous sommes
tous parés pour remonter jusqu'aux sources. Nous revenons légèrement
sur nos pas et prenons un sentier qui monte un peu, redescend puis s'arrête
brusquement près d'un arbre tombé en travers de la gorge. Sur
l'autre rive, nous devinons qu'un sentier se poursuit. Évidemment,
si nous avions été en été, il y aurait eu moins
d'eau et nous aurions pu passer à gué, en sautant d'un rocher
à l'autre.
Là, je ne vois qu'une solution, c'est de passer sur le tronc, et je le dis à haute voix. Michèle m'entend et annonce : "D'accord!" Les bras m'en tombent. Elle qui freine d'ordinaire toute initiative un peu osée et sportive, s'élance sur le tronc derrière son fils qui ne nous a pas attendues et passe en souplesse. Max hurle : "Michèle, tu as vu ton fils ? Mais ça va pas ? Tu y vas aussi ? Mais qu'est-ce qui te prend, fais attention, reviens... !" D'habitude, c'est lui qui prend tous les risques, lui dont le métier est de marcher sur les toits et qui arpente les Pyrénées comme un isard : il n'aime pas être dans ce rôle de spectateur et craint le pire pour sa femme et son fils. Mais rien n'y fait. C'est l'aboutissement d'années de gymnastique, elle se sent prête, souple et apte à passer sans anicroche. Elle en rit de plaisir. Elle me dira après qu'elle était tellement concentrée qu'elle n'a pas vu Richard partir.
Elle
y est allée, pourquoi pas moi ? Je m'avance derrière elle, bien
plus laborieusement. Je suis à califourchon sur le tronc râpeux
et j'avance en m'appuyant sur les mains pour soulever et déplacer les
fesses : la position n'est pas glorieuse, ni très rapide, mais j'avance.
Le problème, c'est pour passer la cuisse par-dessus un moignon de branche
arrachée dans la chute. Le tronc est large, stable, l'écorce
est sèche, il n'y a pas de mousse, Michèle a même terminé
à quatre pattes dessus et Pierre en position debout. Moi, j'ai la tremblote,
mais je veux y arriver. J'y mets le temps qu'il faut et nous nous retrouvons
bientôt à quatre de l'autre côté avec Rose qui a
suivi son mari. Richard et Sylvie sont partis depuis longtemps en devisant
: dès qu'ils ont entendu que le passage était bloqué,
ils se sont dits que nous ferions demi-tour sans imaginer un instant que nous
pourrions nous entêter. Nous sommes donc séparés en trois
groupes.
Ceux de la rive droite, qui se refusent à passer sur le tronc, remontent un peu la pente, contournent les racines arrachées, sautent d'un rocher à l'autre, et gagnent le sentier qui reprend son cours. Nous sommes en face, également sur un sentier, et progressons en parallèle. Bientôt, ils nous invitent avec force gestes et hurlements pour couvrir le bruit des flots à les rejoindre sur deux autres troncs plus en amont qui constituent un pont plus praticable. Michèle et moi, voyant la rive dévastée par l'arrachement de l'arbre, préférons remonter, de plus en plus haut, sur une pente de plus en plus abrupte où le sentier a disparu. Rose et Pierre, par contre, se sont élancés dans le creux des racines et tentent la traversée en nous engageant à les imiter en criant eux aussi. Nous n'allons pas continuer comme ça à escalader la montagne entre les buissons de buis qui embaument, certes, mais ce n'est pas suffisant pour rendre le trajet agréable. Nous craignons de dévaler la pente à tout instant : c'est décidé, nous faisons demi-tour. Pierre nous aide à passer l'obstacle (Michèle tombe dans ses bras - il est ravi -) et nous retraversons.
Le
torrent gronde, l'eau bondit par dessus les rochers glissants, il ne s'agit
pas de tomber. Je passe debout, un pied sur chaque tronc et mes bâtons
plantés devant - je me sens devenir quadrupède. Michèle
préfère passer à quatre pattes sur l'un des troncs, comme
l'autre fois, et s'emmêle dans une branche, elle n'ose plus bouger et
s'agrippe en riant. Pierre vient la délivrer et la fait avancer en
la rassurant de la voix. Rose les encourage de la rive où elle est
passée sans encombre - à chacun sa technique. Pendant nos tergiversations,
Jean-Luc a poursuivi avec les enfants plus loin. Nous sommes de nouveau trois
groupes. De Richard, Sylvie et Diana, pas de nouvelles. Nous apercevons encore
un moment Jean-Luc et les enfants, puis nous nous décourageons de ne
pouvoir suivre la rive tranquillement, le sentier a de nouveau disparu dans
les flots, nous choisissons de monter perpendiculairement (et verticalement)
sur la terre dévastée par l'incendie de l'écobuage et
où percent par endroits quelques brins d'herbe timides.
Heureusement, il n'a pas plu, les mottes ne glissent pas et ne s'effritent pas sous nos pieds. Je suis contente d'avoir mes deux bâtons. Les autres montent à quatre pattes, et même sur les genoux, tout est bon pour s'accrocher et ne pas perdre un centimètre : le sommet est loin et le grondement de la Nive peu engageant. La seule issue est vers le haut. Nous contournons des branches calcinées, peu stables, vidées de leur substance. Max est partagé : il voit Jean-Luc qui poursuit son avancée périlleuse et craint pour ses enfants. Il décide de les rejoindre : cela fait un groupe de plus. Pour une balade que nous devions faire ensemble, c'est une véritable diaspora !
Christophe a décidé de mettre ses pas dans ceux de Jean-Louis. Il est très sportif et monte sans problème. Pierre reste avec les trois femmes (Rose, Michèle et moi), et patiente pendant que nous faisons une pause, épuisées, sur un tapis de mousse confortable au pied d'un grand chêne. Enfin nous atteignons un chemin, celui-là même que nous aurions dû prendre pour atteindre les sources de la Nive. Nous apercevons au retour à une intersection le cairn très discret, marqué d'un trait jaune minuscule, que nous avons manqué à l'aller. Nous revenons aux voitures, espérant y trouver Richard, Sylvie et Diana. Ils sont invisibles. Nous imaginons qu'ils ont fait une balade de leur côté, ou une grosse sieste, croyons reconnaître la voiture de Sylvie un peu plus bas et patientons. Jean-Louis et moi retournons sur le lieu du pique nique pour nous assurer qu'ils ne nous y attendent pas, il n'y a personne. Longtemps après, Max revient, seul. Il n'a pas trouvé Jean-Luc et les enfants, il s'est découragé et a fini par faire demi-tour.
Enfin
Jean-Luc arrive, tenant un des jumeaux par le bras, qui saute à cloche-pied,
sa cheville emmitouflée dans un linge coloré. C'est une mise
en scène : il n'a rien de cassé, il a seulement perdu une chaussure
! En fait, lorsque le sentier s'est interrompu, ils ont sauté de roche
en roche. Arrivés dans un goulet, le torrent enserré entre deux
falaises, Jean-Luc a avancé dans l'eau glacée, les enfants ont
sorti leurs chaussures et remonté leurs pantalons et ils ont progressé
ainsi, de plus en plus loin. Devant les difficultés croissantes, ils
ont rejoint la rive, se sont rechaussés et ont grimpé comme
nous à flan. L'un des enfants a dévissé sur plusieurs
mètres, perdant sa chaussure qui a disparu. Ils ont fini par atteindre,
comme nous, le sentier des sources et nous ont rejoint. Les yeux des enfants
brillent. Quelle aventure !
Nous ramenons Christophe chez ses hôtes et Richard nous raconte qu'ils nous ont attendu plus d'une heure, ont pris un café, et sont rentrés à la maison... La prochaine fois, il ne faudra pas se séparer, c'était dommage de n'être pas ensemble et nous nous sommes inquiétés les uns pour les autres, nous cherchant et nous attendant mutuellement : à ne pas refaire ! (Mais quand même, je me souviendrai toujours de ces traversées du torrent sur les troncs d'arbres, cette marche sur des rives incertaines et cette montée abrupte vers une cime inaccessible sur une terre dévastée par le feu !)